|
Trois
grandes tendances observées lors du colloque
[Lire
le texte]
« Pour
aller du plus réduit au plus large, il y a l'intermédialité
comme un métissage de médias d'ores et déjà différenciés voire,
si l'on rabat les médias sur les arts, une hybridation des pratiques
artistiques.
Deuxième
tendance, déjà un petit peu plus vaste que celle-là et qui engage
un autre type de méthode, de regard, dans la mesure où c'est un
propos plus historique: l'intermédialité serait un ensemble de
codes médiatiques dont un média doit toujours se dégager afin de
parvenir à son autonomie. Cela peut se faire selon une sorte de
principe de gestion, soit de gestion d'une crise, soit de gestion de
cette part irrémédiable que semble avoir nécessairement
l'intermédialité au tout début d'un médium, ou bien selon un
principe de biologie […].
Enfin,
troisième point, l'intermédialité, - et là de manière beaucoup
beaucoup plus vaste - comme […] un contexte actif d'agencements
symboliques, qu'ils reposent sur des matérialités ou des relations.
Si on veut le dire de manière beaucoup plus simple, je pense qu'on
peut simplement dire: ce qui traite des médias comme des milieux.
« Milieu » étant, étymologiquement, un des sens de
« médium », évidemment. »
  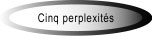
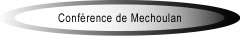
|